Notes de lecture du livre Le capitalisme sans rival de Branko Milanovic
Branko Milanovic est un économiste spécialisé dans l’étude des inégalités économiques. Son nom est peut-être moins associé à ce domaine que d’autres comme Thomas Piketty ou Gabriel Zucman mais il a publié plusieurs ouvrages remarqués sur le sujet. Son compte Twitter (X) fait partie de ceux que je suis avec attention.
Il est connu, entre autres, pour sa courbe dite de « l’éléphant » qui montre que le développement économique des dernières décennies a réduit les inégalités entre pays au bénéfice des classes populaires des pays pauvres (surtout en Asie) mais a augmenté celles à l’intérieur des pays plus développés avec une pression sur les salaires de la classe moyenne.
Dans cet ouvrage datant de 2019, l’économiste s’attaque à un sujet un peu plus politique : comment expliquer la victoire du capitalisme comme seul système d’organisation économique ?
Il définit tout d’abord les deux grands types de capitalisme que nous connaissons actuellement : capitalisme libéral méritocratique d’un côté et capitalisme politique de l’autre avant d’aborder l’impact de la mondialisation et enfin se projeter dans l’avenir.
Capitalisme libéral méritocratique
Cette première variante (qui est celui que nous connaissons dans la plupart des pays occidentaux) est capitaliste car les modes de production et d’échange sont privés, libérale car il y a une certaine mobilité sociale et enfin méritocratique car la répartition des biens est moins arbitraire que dans d’autres régimes grâce à l’accès à l’éducation et la taxe sur l’héritage.
Cela n’a pas empêché la hausse de la part du capital dans la production, hausse qui a profité principalement aux plus riches ce qui a accentué les inégalités. 90% du patrimoine financier est détenu par les 10% les plus riches. De plus ,le capital pour la plupart de la population aux USA (60%) se résume à leur maison ce qui les rend plus vulnérables aux fluctuations du prix de l’immobilier comme en 2008. Enfin le rendement de ce secteur est plus faible (~1%) que celui du marché financier (~6%).
On voit apparaître une nouvelle classe dans nos sociétés, ceux qui possèdent non seulement du capital mais en plus touchent un haut-revenu. L’auteur la nomme « homoploutia » (« même richesse »). Dans la population qui touche un haut revenu du capital ils étaient 15% en 1980 à aussi toucher un haut revenu du travail, maintenant ils sont 30%. Il est donc plus difficile d’augmenter la taxation du travail et du capital car une classe influente et plus nombreuse va voir cette augmentation comme une attaque contre leurs intérêts. Enfin les gens se marient de plus en plus entre personnes de la même classe sociale. Ce qui n’était pas le cas avant où la femme pouvait venir d’une classe populaire, maintenant on choisit son conjoint à l’université où on se retrouve entre personnes de même statut économique et social. Les x% ménages plus riches sont donc un groupe encore homogène qu’avant, le brassage social est moins fort.
Les outils de l’État-providence mis en place après-guerre comme les syndicats, l’éducation et la redistribution sont en panne dans leurs impacts:
- La nature du travail, les services et la mondialisation ne permettent plus un fort syndicalisme qui défend une meilleure répartition entre travail et capital
- L’éducation a porté ses fruits mais on a atteint un plateau, maintenant tout le monde est plus ou moins éduqué. On constate de plus une forte inégalité entre école publique et privé, ces derniers captant plus de moyens matériels et humains.
- Les impôts et la redistribution fiscale sont de plus en plus difficile à faire passer dans l’électorat d’aujourd’hui
L’auteur pose le constat qu’on peut plus ignorer l’impact qu’a l’immigration sur les sociétés notamment européennes. Elle mets sous pression les systèmes de redistribution, un effet pervers s’installant: ces pays ayant une grande couverture sociale (« safety net ») attirent des migrants sous-qualifiés car ils savent que leur situation sera moins pire du fait d’un état providence fort (et d’un autre côté les USA vont attirer des immigrants plus qualifiés car ils savent qu’ils vont pouvoir être potentiellement plus riches).
On reviendra sur ses pistes de solution plus loin.
Dans d’autres domaines, il cite:
- Favoriser la participation sur les marchés financiers des petits ménages pour augmenter leur part du capital et profiter de son rendement supérieur
- Mais aussi leur participation dans les entreprises où ils travaillent
- Augmenter la taxe sur héritage pour réduire la concentration des richesses
- Limiter les contributions politiques des gens très riches (SuperPAC aux USA)
Capitalisme politique
Il existe deux grandes familles d’explications de l’évolution des sociétés : « Athènes » (Platon) où on mets en avant l’existence de cycles entre la tyrannie, la démocratie et la ploutocratie et la seconde dite de « Jérusalem » (théologiques) qui trace un chemin clair mais plus de libertés, etc. Le libéralisme et le communisme sont de cette dernière école. Pour les communistes, le chemine étant féodalisme puis capitalisme, socialisme et enfin le communisme.
Mais le libéralisme n’explique pas le retour en arrière qu’est par exemple la guerre de 1914 alors que toutes les sociétés convergeaient vers le capitalisme ou étaient déjà capitalistes. De son côté le communisme n’a pas anticipé 1989 où la plupart des pays du bloc se sont tournés vers le capitalisme.
Les deux n’arrivent pas non plus à donner une place aux pays du tiers-monde. Ils sont vus comme des colonies qu’on va éduquer mais en fait on se contente d’extraire des ressources. Il y a bien eu un mouvement dit structuraliste en Amérique latine qui militait pour sortir de cette dépendance à l’extraction de matières premières. Ils envisageaient de construire des centres de productions industrielles indépendants de l’Occident mais cela n’a pas été mis en oeuvre quand ses supporteurs sont arrivés au pouvoir, par exemple au Brésil.
Pourquoi le communisme a échoué dans les pays de l’Est européen alors qu’il a réussi à s’adapter en Asie ? Après le rattrapage suite à la Seconde Guerre mondiale, la productivité a stagné et la répartition travail-capital étant fixe, la croissance est limitée par le facteur le plus abondant, quand la population cesse de croître cela devient un problème car le capital ne prend pas la suite comme levier de croissance.
Pour l’auteur, on peut expliquer le communisme comme une voie temporaire pour les pays en voie de développement vers le capitalisme comme en Chine, Vietnam, etc. Le communisme a réussi dans ces pays car il a pu mener les deux révolutions nécessaires pour améliorer le sort de la population: la première contre le féodalisme et la seconde contre l’impérialisme occidental qui était extracteur de richesses.
La Chine est un pays capitaliste car les entreprises et la main-d’œuvre privées sont majoritaires, une grande part de la prise de décisions est décentralisée dans les provinces et l’agriculture n’est pas étatique.
On peut définir le capitalisme politique comme ayant un secteur privé dynamique avec le pouvoir d’une bureaucratie efficace et un système politique à parti unique. Mais cela amène deux contradictions : 1) il existe une zone de non-droit d’un côté la bureaucratie rationnelle et l’aspect discrétionnaire de l’application de la loi 2) la corruption qu’engendrent le parti unique et cette zone de non-droit.
Les pays du capitalisme politique sont la Chine, le Vietnam, la Malaisie,le Rwanda ou encore Singapore.
La corruption est maintenue à un niveau « acceptable ». La classe des capitalistes en Chine n’a jamais été une classe en soi car l’État a toujours eu un plus grand pouvoir de contrôle et ceci depuis la dynastie Song. C’est une administration centrale très forte qui tient à carreau les marchands.
Est-ce que la Chine va exporter son modèle ? Elle l’a peu fait dans le passé, elle a eu peu d’influence en Europe à part en Albanie.
La Chine a réussi car c’est un grand pays qui a pu faire coexister une forte centralisation politique avec une décentralisation économique (les gouvernements locaux peuvent innover, par exemple les privatisations ont commencé au niveau local). Ce n’est pas quelque chose qui est facilement exportable.
Travail au temps de la mondialisation
Être citoyen d’un pays riche c’est comme percevoir une rente (ou une prime) qui représente le surplus de salaire pour une personne de même niveau d’éducation d’un pays plus pauvre.
La migration du capital et du travail ont des effets différents même si la migration du capital peut être aussi source de perturbations (par exemple une entreprises occidentales dans un pays pauvre arrivant avec une organisation qui permet le travail des femmes) on se focalise souvent sur celle du travail.
Les citoyens des pays riches bénéficient donc d’une rente car ils vivent dans un pays où 1) les salaires sont plus élevés 2) il y a une bonne couverture sociale et 3) on bénéficie d’une forte protection légale avec procès équitable, etc.
Il y a une tension entre accepter plus d’immigrants mais cela met à risque la cohésion de ce système. Si on acceptait tout le monde dans le cadre de la libre circulation des personnes il faudrait démanteler une bonne partie de l’état-providence ou limiter les droits des migrants.
Cette tension a mal été reconnue pour les gens de gauche car d’un côté il y a un réflexe anti-mondialisation, on dénonce les délocalisations mais d’un autre on veut aussi combattre les inégalités mondiales.
La solution pragmatique est de choisir un point sur la courbe qui va de tous les droits accordés aux migrants mais alors on limite drastiquement le nombre de migrants acceptable par la population locale (comme en Europe) à peu de droits mais beaucoup de migrants (comme Singapore ou Dubai).
Il imagine un mécanisme qui permet une immigration qui soit acceptée par la majorité de la population via un statut de « citoyen temporaire » avec des droits limités, un peu comme on peut le voir au Canada avec le système de résident permanent mais qui toucherait plus de facettes de la vie. Ce système limiterait dans une certaine proportion et dans le temps :
- Les droits civiques (par exemple droit de vote limité aux élections locales)
- Les droits sociaux (plafond de dépenses, délai de carence)
- La mobilité professionnelle avec un visa lié à une entreprise / un secteur économique
- Le séjour dans le pays d’accueil
Il faut trouver la bonne modulation entre ces paramètres pour sortir de la vague populiste qui touche beaucoup de pays sur ce sujet.
Mondialisation du Capital
Il a fallu emplir deux conditions pour le développement du commerce mondial : la possibilité par des entreprises de contrôler à distance le processus de production et une protection égale de la propriété au niveau international.
Sans celles-ci on produisait et consommait localement.
La première mondialisation, grâce à la révolution des transports, on a pu découplé production et consommation, on achetait à l’étranger des biens produits par d’autres. Mais cela reste très mercantile.
La deuxième mondialisation a permis le découplage de la production elle-même: le design et le contrôle sont faits ici mais la production là-bas. C’est cette dernière qui a provoqué des remous dans les pays développés car cela a supprimé la fameuse prime de citoyen dont on a parlé plus tôt pour les employés peu qualifiés (La troisième mondialisation serait celle des personnes qui peuvent circuler ou intervenir à distance).
Les pays en voie de développement n’ont donc plus à suivre le chemin classique de la substitution des importations par des barrières tarifaires comme l’a fait le Japon. L’important est de s’intégrer dans la chaîne de valeur technologique mondiale comme l’a fait le Vietnam, Taïwan, etc. Ces pays peuvent devenir des leaders technologiques comme la Turquie, la Chine ou l’Inde.
Un fait marquant: la Chine sera au même niveau de revenu par habitant que les pays occidentaux en 2040, c’est presque « demain ».
Corruption à l’heure de la mondialisation
Il est difficile de dire si elle a augmentée car on connaît mal les flux ceux-ci incluant un autre phénomène qu’est l’évasion fiscale. Mais 1) l’accumulation de richesses est devenue la mesure du succès au niveau mondial 2) la mondialisation a facilité le transfert de capitaux et on a des gens qui facilitent ces transferts.
Exemple: Le premier pays investisseur étranger en Inde est l’île Maurice, ce sont en fait des capitaux indien déguisés qui reviennent dans le pays.
La corruption est générée par une différence de revenus et est inhérente à la mondialisation. À contrario de l’évasion fiscale qui est plutôt facile à régler, les types de corruption sont plus difficiles à résoudre, un peu comme la drogue ou la prostitution, on peut porter un jugement moral mais les attaques sur l’offre ou même la demande sont rarement productifs.
L’avenir du capitalisme
Le capitalisme a un côté « lumière »: il permet l’ascension sociale, l’argent est aveugle de la couleur de la peau, la classe, le sexe, etc. Son côté « obscur » est la cupidité, l’égoïsme engendrés par l’accumulation de richesses.
Cette tension a été tenue en équilibre pendant longtemps grâce à la religion (on cite souvent l’exemple du protestantisme mais cela vaut pour beaucoup de mouvements religieux) ou par un fort contrat social (la social-démocratie) mais avec la mondialisation et la sécularisation, cet équilibre disparaît.
La morale a été externalisée, trois forces étant en jeu :
- La taille des familles se réduit. Quand la production était hyper-locale, une grande famille était nécessaire pour subvenir à nos besoins. On a externalisé beaucoup de nos tâches de production (on ne pense plus à faire son propre pain mais maintenant ce sont même les repas qui sont externalisés)
- La marchandisation de la production atteint notre temps libre et la sphère privée (sa voiture avec Uber, son logement Airbnb, etc.) ne pas avoir de « side hustle » c’est manquer un revenu complémentaire
- La flexibilité du travail avec l’émergence d’une classe de travailleur « à la demande » qui va d’occupation en occupation sans avoir de poste fixe
Ces trois forces mettent à mal la bienveillance qui est issue d’un contact long et répété et elle se délie quand tout devient temporaire.
Ce chapitre contient aussi deux apartés: le premier sur le revenu universel qui ne le convainc pas plus que ça (très lourd à mettre en place fiscalement parlant et on a pas de recul à part quelques études sur un petit nombre de personnes). Le deuxième sur le pessimisme mal placé des gens quant au progrès technique ou à l’automation. On a tendance à réfléchir en terme de stock pour l’emploi, on n’envisage pas le caractère dynamique de l’économie et donc tout impact semble négatif.
Conclusion
La lecture de ce livre m’a rappelé celle des essais de Paul Krugman dans les années 2000. L’écriture est simple, il y a une clarté dans le raisonnement et il expose aussi les limites de son approche.
Sa description du capitalisme politique me paraît pertinente. Et ceci d’autant plus qu’on a parfois l’impression que nos gouvernements en Europe ou en Amérique du Nord n’arrivent plus à « exécuter » leur programme, on est comme paralysés. Le dynamisme des économies asiatiques rend attrayant un pouvoir plus centralisé voire autocratique. Mais les pistes exposées par Branko Milanovic pour baisser d’un côté les inégalités frappant le travail et d’un autre offrir un meilleur chemin d’intégration aux immigrants me paraissent bonnes à être explorées par les partis politiques.
Cette note est un résumé donc le propos de l’auteur peut paraître abrupt comme sur le question de l’immigration mais sa réflexion est très détaillée et, surtout, il fait tout cela avec humilité. L’objectif de ma fiche de lecture est de piquer votre intérêt pour que vous puissiez lire cet ouvrage par vous-même. Je suis sûr que cela vous fera réfléchir bien après la fin de sa lecture.
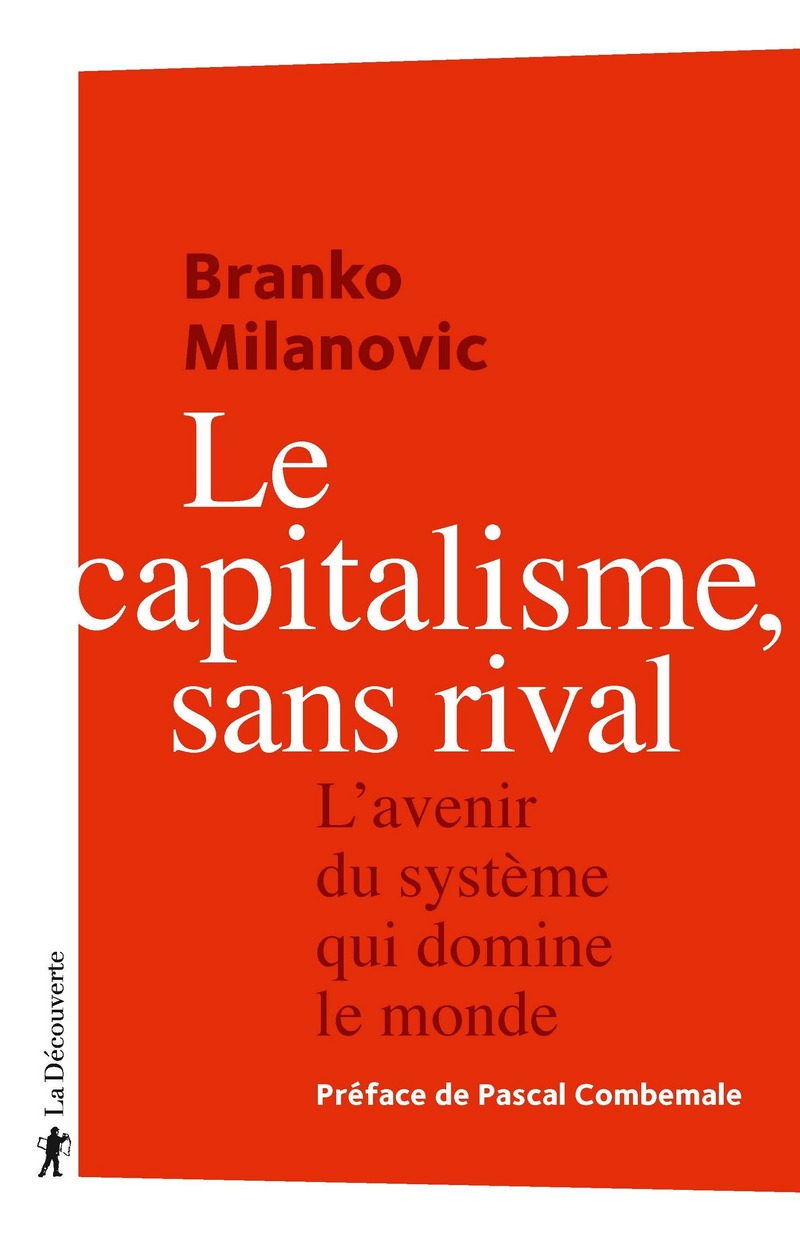
Billet publié dans les rubriques Lectures on